
Position après le 38...Tcc3
Historique
de l'Echiquier de la Tour d'Argens
:
L'Association de l'Echiquier de la
Tour d'Argens à été créée le 21 avril 2001 sous l'impulsion de quatre
amateurs et
passionnés du Noble Jeu : Renaud Gaillard (Vice Président), Nicalas Mac Carty
(Trésorier), Philippe Chalumeau alias Chalûmov (Secrétaire) et Stéphane
Bidet (Formateur).
Elle participe aux compétitions fédérales, régionales
et départementales !
*Equipe Jeunes (8 échiquiers) en Championnat de France
Nationale 3.
*Equipe Jeunes (8 échiquiers) en Nationale 5.
*Equipe
Adulte (4 échiquiers) en Championnat Départemental 2.
Elle a créée en
septembre 2002, une Ecole d'Echecs Jeunes "Le Petit Roque Arcois".
Frequentée
régulièrement par de nombreux enfants, elle propose chaque Mercredi
après-midi, des initiations, commentaires de parties et des
Tournois permanents toutes cadences confondues).
L'Ecole d'Echecs Jeunes est
dirigée par Stéphane Bidet - pour le contacter : Cliquez ici
Notre Association participe
également aux manifestations culturelles de notre commune (Les
Arcs).
Spectacle des Médiévales, Journée des Associations, Journée du
Patrimoine, Téléthon ...
Elle organise en outre, chaque fin d'année (Mois de
Mai), son Grand Prix Jeunes "Le Petit Roque Arcois" ou une centaine de
jeunes
s'affronte dans un excellent état d'esprit pour conquérir le titre, très
convoité de Champion Jeunes des Arcs sur Argens.
Informations Utiles :
Les Membres cliquez ici : Les joueurs par Elo
Les Horaires :
Club Adultes : Mardi de 18h à 20h / Vendredi à
partir de 21h.
114 membres au 01.01.2004
Ecole d'Echecs Jeunes "Le Petit Roque Arcois" - Mercredi de 14h à 17h.
Salle de jeu :
Château Morard, Maissons des Associations 83460 Les Arcs sur Argens.
71ème club français en nombre de licences : 114 - Nombre d'habitants : 5334 - Ratio joueur : 5,81 % au club d'Echecs.
Renseignements, Inscriptions :
Par mail ici : L'Echiquier de la Tour
d'Argens
Par téléphone : 04.94.85.25.29 - 06.81.10.55.78
Par courrier : Siège administratif /
Echiquier de la Tour d'Argens
Rue Ernest Renan - 83460 Les Arcs sur
Argens.
________________________
Les Echecs au Moyen-Âge du Xè au XVè siècle.
Le jeu d'échec représente un des passe-temps favoris de nos ancêtres. Néanmoins, son histoire est souvent mal connue et il a fortement évolué au cours des siècles.
Evolution du jeu en Europe.
Historiquement, l'ère européenne du jeu d'échecs débute en l'An Mil. A cette date, la variante raisonnée a achevé de se répandre jusqu'aux confins septentrionaux du continent. L'expansion a connu une accélération foudroyante dans les ultimes décennies du millénaire, période critique durant laquelle les cultures musulmane et byzantine rayonnent sans égal sur l'Europe.
La première trace écrite du jeu d'échecs en Occident se trouve dans un acte catalan daté de 1008, par lequel le comte d'Urgel Ermengol (ou Ermengaud), lègue un de ses échiquiers à l'Eglise Saint-Gilles. D'autres textes de la première moitié du XI ème siècle mentionnent également la présence de "Tabulas" ou "d'escacs". Curieusement, deux des témoignages écrits les plus anciens attestant d'une pratique assidue sont l'un, une éloge en vers composé par un moine, l'autre, le récit d'une leçon de morale chrétienne donnée par un cardinal à un évêque, joueur endiablé.
Le poème, intitulé Versus de scachis, est rédigé vers l'an 1025 par un moine demeuré anonyme du monastère d'Einsiedeln, situé près de Zurich. Il livre des enseignements précieux sur les règles en usage, dont celui-ci : "Il y a des gens à qui cela plaît de teindre les tablettes de deux couleurs." L'autre témoignage date de 1061. Le cardinal a pour nom Petrus Damiani. Il raconte, dans une épître adressée au pape Alexandre II, comment il contraignit l'évêque Gérard, "pour s'être adonné (aux échecs) toute une soirée dans une auberge, à réciter trois fois le psautier, à laver les pieds de douzes pauvres et à gratifier chacun d'un écu.
Cette scène "à l'italienne" dut être cocasse, sinon tragique. Elle précise néanmoins ce que sera la "controverse ecclésiastique", jusqu'à l'aube du XIV ème siècle : à savoir, plus les pères de l'Eglise tonneront contre "ce jeu vaniteux, qui laisse le corps en langueur et n'apporte guère de profit", comme le dénonce par ailleurs Jean de Salisbury, évêque de Chartres, plus les prêtres, les diacres et les moines dirigeront "leurs pas vers ce lieu de l'esprit, ou il n'existe nul parjure dû à la mauvaise foi".
Après avoir introduit le sacré, le jeu s'attaque à présent au profane. Le jeu d'échecs se retrouve dans les castels retranchés, par le biais des chansons de geste, colportées par les trouvères. Il faut dire que la vie seigneuriale se partage exclusivement entre la paix et la guerre. Or, durant les mois de trêve hivernale, les distractions sont rares, hormis la chasse. C'est tout naturellement que le "jeu des rois" devient le "roi des jeux" pour les classes oisives et guerrières.
A la fin du siècle, cette terminologie est devenue courante et les références aux échecs se multiplient, commençant même à gagner la littérature. Les échecs connaissent un indéniable succès dès leur apparition sur le continent, même si leur pratique reste dans un premier temps limitée aux ordres supérieurs. En 1106, l'Espagnol Pedro Alfonsi, mathématicien à la cour du roi de Castille, présente le jeu d'échecs, dans son traité sur les moeurs de la noblesse, Disciplina clericalis, comme l'une des sept disciplines dans lesquelles un chevalier se doit d'exceller.
Sur le plan de l'étymologie, le mot échec dérive du latin scac, traduction littérale du vocable shah qui, chez les Arabes, désigne outre le nom de la pièce, une "mise en échec" du roi. Les Anglo-Saxons convertissent ce vocable en check (pluriel chess) ; les Italiens adoptent la terminologie de scacco (pluriel scacchi) soit "pillage", "mise à sac".
Passe-temps privilégié de la noblesse, le jeu rencontre également de fervents adeptes au sein même de l'Eglise, ce qui n'est pas sans émouvoir les autorités ecclésiastiques qui, dès la fin du XI ème siècle, multiplient les condamnations. Ces attaques peu efficaces visent à interdire un divertissement conduisant à l'oisiveté et laissant une trop grande part au hasard (alea), puisque l'habitude orientale d'utiliser un dé est toujours en vigueur. Malgré la vindicte de l'Eglise, le jeu se répand au XII ème siècle dans toutes les catégories sociales, en milieu urbain comme en milieu rural.
Cependant, une mutation profonde des moeurs seigneuriales s'opère. A partir de 1189, les croisades se succèdent ; les chevaliers reviennent de Terre sainte écoeurés par l'odeur de sang, tout autant qu'enivrés des effluves capiteux qui s'exhalaient des cours fastueuses d'Orient. En outre, les gentes dames ont occupé dans les domaines les places laissées vacantes par leurs seigneurs. Les châtelaines se muent en actrice du jeu. Le jeu lui-même se pare d'une auréole courtoise. Et lorsqu'il affronte ces rivales, le gentilhomme ne simule plus la véritable guerre, comme ses prédécesseurs, il la chante.
Les héros des romans de chevalerie les plus renommés sont représentés du reste tels de fervents adeptes :
Huon de Bordeaux s'extrait ainsi des griffes de son geôlier sarrasin en séduisant sa fille unique lors d'une partie "aux traits". La jouvencelle refuse d'être "la cause de la mort d'un si bel homme", elle s'émeut et se laisse mater.
L'un des preux chevaliers, héros du cycle de la Table ronde, a pour nom Palamède. Il s'en revient d'Orient et son blason est un échiquier noir et blanc. Outre les romans, poèmes ..., les traités techniques sur le jeu apparaissent la fin du XIII ème siècle.
Alphonse X le sage, roi de Castille et de Léon, fit composer, en 1283, un traité intitulé Juegos diversos de axedrez, dados y tablas . Cet ouvrage, célèbre par la richesse de ses illustrations, renferme une compilation de 103 problèmes, recopiés d'après des manuscrits arabes.
Mais le plus ancien et le plus célèbre, est un manuscrit italien, daté de 1275, intitulé Bonus Socius. Ce traité inaugural, rédigé en latin, est attribué au sieur Nicolas de Nicolaï. Il comprend 119 feuillets, décorés de diagrammes. L'auteur n'a pas voulu composer un ouvrage didactique. Il n'explique aucune règle, bien que celles-ci se révèlent être celles du jeu Lombard. Chaque problème est introduit par une formule lapidaire, du type : "Les pièces d'or opposées aux rouges en deux traits." Et chaque diagramme est assorti des coups de la solution conduisant au mat, sans autre forme d'explication. D'ailleurs la chronique relate que le poète Charles d'Orléans, père du roi Louis XII, en possédait une copie.
Face à la popularité croissante du jeu, l'Eglise adoucit sa politique, de sorte que les condamnations se font plus rares et moins virulentes à partir du XIII ème siècle. Les cases sont à présent alternativement noires et blanches, ou rouges et blanches. En outre les joueurs ont substitué une reine au vizir arabe, sans fondement dans la culture occidentale. Cette nomenclature harmonieuse et conforme aux us médiévaux accélère encore la pénétration du jeu, y compris dans les couches ecclésiastiques, demeurées, cependant, les plus réfractaires.
Joinville, nous rapporte, dans ses chroniques de la vie de Saint Louis, que le "vieil de la montagne" offrit, en 1248, en présent au roi de France, alors à Saint-Jean-d'Acre, un "jeu d'échecs de cristal, fleureté d'ambre et vigneté à l'or fin". Ce généreux donateur n'était autre que Rashid al-Din as-Sinin, le chef des assassins ou Hashischins, une secte musulmane chi'ite qui, au temps des croisades, se livrait à toutes sortes d'exactions sous l'emprise de la drogue.
La Bibliothèque Nationale (à visiter ici http://classes.bnf.fr/echecs) conserve plusieurs pièces d'un jeu d'échecs en ivoire dit "Jeu de Charlemagne" qui aurait été offert au grand empereur par le Commandeur des Croyants des Mille et Une Nuits, le calife Haroun-al-Rachid. Mais s'il n'est pas impossible que Charles ait reçu un tel cadeau, les experts ont établi que le jeu en partie conservé est largement postérieur à l'empereur à la barbe fleurie. Il daterait de la fin du XI ème siècle, proviendrait d'un atelier de sculpture sur ivoire existant alors, dans la ville de Salerne, au sud de l'Italie et il pourrait avoir été acquis par Philippe-Auguste ou l'un des autres rois dont le passage à Salerne est enregistré par l'histoire.
L'acceptation de ce présent par le roi de France ne pouvait plus entraver, par les autorités ecclésiastiques, la marche en avant du pion sur l'échiquier, et ce, malgré les ultimes interdits, dont le plus remarquable aura été une ordonnance de Saint-Louis, lui-même, huit-ans plus tard, datée de 1254. Le roi de France déclame avec véhémence : "Nous défendons que nul ne joue aux dés, aux tables (backgammon) et aux échecs". Car, si le jeu s'y était introduit noblement, c'est de la folie du jeu qui a gagné les villes et les campagnes. Les joueurs sont devenus avides au gain. Les parties font l'objet des enjeux les plus divers. Certaines dégénèrent parfois en pugilat. D'autres encore se disputent "aux dés", car peu importe, en fait, la manière dont la victoire est remportée.
Au contact des ribauds, les gentilshommes se dévoient. Parfois, dans les tavernes, il y a meurtre autour de l'échiquier. Ils s'agit de moraliser, tonnent les prélats. Ainsi, au siècle suivant, pour assagir les esprits, l'Eglise tente de donner une coloration morale et religieuse aux échecs, comme l'illustre le célèbre "Liber de Moribus" du dominicain Jacques de Cessoles.
Jacques de Cessoles, moine dominicain, originaire de la région d'Asti, en Italie, propose à ses concitoyens de méditer sur "l'amusant jeu des échecs, qui contient un enseignement remarquable quant à la conduite des moeurs ainsi que celle de la guerre". Ses sermons ont l'heur de plaire à moult de ses compagnons de l'ordre des Frères prédicateurs. Vers 1315, "sur leur insistance", dit-il, il transcrit par écrit son sermon, qu'il enrichit de quelques paraboles antérieures conçues sur le même mode allégorique. Le Livre des moeurs des hommes et des devoirs des nobles, au travers du jeu d'échecs (ou Liber De Moribus) va témoigner de l'engouement extraordinaire de la société médiévale pour le jeu des rois.
En voici un extrait :
"Alors, le philosophe commença à instruire le roi de Babylone de la marche des pièces, en lui disant d'abord que le Roi doit posséder la clémence, la justice, la continence. Il l'instruisit aussi de la forme de la Reine et de son mouvement, précisant quelles devaient être ses moeurs. Il l'instruisit des Fous, juges et justes conseillers dont la présence dans le royaume est indispensable. Même chose pour les Cavaliers qui doivent être sages et généreux. Même chose pour les vicaires du roi (les Tours) et leurs moeurs au sens noble du terme. Il l'instruisit également des devoirs des gens du peuple (les Pions), laboureurs et cultivateurs, forgerons, drapiers et notaires, marchands et changeurs, chirurgiens et apothicaires, aubergistes, gardiens de la cité et receveurs, ribauds, joueurs et messagers, qui doivent servir les nobles, puisqu'ils sont placés devant eux".
Le traité du moine dominicain devient l'ouvrage le plus traduit, copié, puis imprimé en Europe durant deux deux siècles, après la Bible. En 1337, le moine suisse Conrad d'Ammenhausen achève la rédaction de la première version allemande en prose. Quant à la première édition imprimée, elle est datée de 1473, à Utrecht, aux Pays-Bas. Les analyses fleurissent sous la plume d'ecclésiastiques renommés : Jean de Salisbury , Jean de Galles, Le pape Innocent III, Maurice de Reval ....
En voici quelques extraits :
Jean de Galles : "Le pion, dans sa simplicité, marche droit devant lui, mais lorsqu'il prend, il le fait obliquement. Ainsi l'homme, tant qu'il reste pauvre, marche dans la droiture et vit honnêtement, mais lorsqu'il recherche les honneurs, il flatte, se parjure et, par les voies obliques, cherche une position supérieure sur l'échiquier du monde".
Maurice de Reval : N'avez-vous jamais remarqué comment le joueur d'échecs retient longuement dans sa main la figurine qu'il a retirée de l'échiquier, considérant la case où il la reposera hors de portée de l'ennemi ? Faites ainsi avec votre coeur, et gardez-vous de le placer dans un lieu de malheur".
Ce faisant, l'Eglise contribue à renouveler la véritable mythologie qui s'est cristallisée autour des échecs depuis leur apparition en Occident.
Symbolique des échecs.
Une symbolique s'est dessinée autour du jeu d'échecs bien avant même que les théoriciens ne s'évertuent à dresser des comparaisons entre les pièces de l'échiquier et la composition de la société. Pour les Occidentaux des XI et XII ème siècles, les références des échecs à l'art militaire et à la structure féodo-vassalique paraissent évidentes. Pour autant, le but final du jeu, qui est d'obtenir la victoire par la mort du roi ("Shah-mat" en persan, d'où notre "échec et mat") déconcerte les contemporains. Les guerres, à cette époque n'ont pas pour objectif véritable d'abattre la partie adverse, mais plutôt de l'affaiblir en la harcelant constamment. L'idée même d'une bataille rangée entre deux armées est un peu déroutante à une époque où les affrontements se font généralement entre troupes de petites tailles et se terminent plus souvent au coucher du soleil qu'à la défaite de l'adversaire.
Mais les croisades contribuent bientôt à fixer le principe de combats sans merci, et la table de jeu apparaît alors comme la reproduction miniature d'un champ de bataille dont la pratique assidue favorise l'apprentissage tactique de la guerre.
Avec l'Amour Courtois, les références militaires du jeu s'estompent au profit de considérations plus poétiques et l'échiquier devient davantage le reflet de la cour que celui de l'armée. Ainsi l'auteur des Echecs Amoureux, une oeuvre du XIV ème siècle dans laquelle les tours ont pour noms "Doux Regard" et "Bel Accueil", nous indique que la forme de l'échiquier signifie l'égalité, la justice et la loyauté et que ces trois états doivent résider dans l'Amour.
Il est facile de concevoir que, dans un Moyen Age féru de symbolique, le jeu d'échecs prête à nombre d'interprétations. La structure en damier du plateau fait de l'échiquier un lieu de mouvement perpétuel, où les pièces changent de statut aussi facilement que l'être humain peut passer de vie à trépas. De nombreuses représentations médiévales du jeu opposent d'ailleurs un joueur ordinaire à une mort personnifié.
Le nombre même des cases de l'échiquier (64) est pour les hommes du Moyen Age très significatif. 64 = 4 , or le chiffre quatre est omniprésent dans la vie quotidienne (Les quatre saisons, les quatre âges de la vie, les quatre vertus, points cardinaux, ...). De la même façon, l'exclusivité de la forme carrée sur le plateau de jeu ne peut conduire aux discours ésotériques les plus divers.
Le texte suivant a éte écrit par un moine dominicain, anonyme, du XIII ème siècle.
"Le monde ressemble à un échiquier dont les cases sont alternativement blanches et noires, pour figurer les deux états de la vie et de la mort, de la grâce et du péché. Les pièces de cet échiquier sont commes les hommes ; ils sortent tous d'un même sac et sont placés dans différentsétats pendant leur vie ; leurs noms sont aussi différents ; l'un est appelé Roi, l'autre Reine, le troisième Roc, le quatrième Chevalier, le cinquième Alphin, le sixième Pion. Ce jeu est de telle sorte qu'une pièce en prend une autre ; et quand le jeu est fini, elles sont toutes déposées ensemble dans le même lieu, de même que l'homme ; et il n'y a aucune différence entre le Roi et le pauvre Pion, car il arrive souvent, lorsque les pièces sont jetées dans le sac, que le Roi se trouve au fond ; et ainsi se trouveront plusieurs des grands de ce monde lorsqu'ils passeront dans l'autre.
Dans ce jeu, le Roi se porte dans toutes les cases qui l'avoisinent et prend tout en ligne directe, ce qui indique que le Roi ne doit pas négliger de faire justice à tous selon le droit, car, de quelque manière qu'agisse un Roi, on le tient pour juste, et ce qui plaît au souverain à force de loi.
La Dame, que nous appelons Fers, marche et prend, en suivant une ligne oblique, parce que les femmes, étant naturellement avares, prennent tout ce qu'elles peuvent, et étant souvent sans mérite ni grâce, sont coupables de rapines et d'injustices.
Le Roc est un juge qui parcourt tout le pays en ligne directe, et ne doit rien prendre d'une manière oblique, par cadeaux ou présents, ni épargner personne.
Le Chevalier , en prenant, fait un pas en ligne directe et un autre en ligne oblique, ce qui indique que les seigneurs peuvent prendre justement les redevances qui leur sont dues et des amendes équitables de ceux qui les ont encourues suivant l'exigence des cas ; leur troisième case étant oblique signifie la conduite de ceux d'entre eux qui agissent injustement.
Les Alphins sont les divers prélats de l'Eglise, papes, archevêques et évêques qui sont élevés à leurs sièges moins par l'inspiration de Dieu que par l'autorité royale, le crédit, la brique et l'argent comptant. Ces Alphins se meuvent et font trois pas obliquement pour prendre, car il n'y a que trop de prélats dont l'esprit est perverti par l'amour, la haine ou l'intérêt : de sorte qu'au lieu de reprendre les coupables et de sévir contre les criminels, ils les absolvent de leurs péchés ; et ainsi ceux qui auraient dù détruire le vice sont devenus, par avarice, les suppôts du vice et les avocats du démon.
Toutefois s'il ne faut pas minimiser la quantité et l'importance des symboles véhiculés par les échecs au Moyen Age, gardons nous de réduire ces derniers à une occupation purement mystique ou intellectuelle. Les échecs sont avant tout un jeu, et considérés comme tels au XI ème siècle comme de nos jours.
L'échiquier comme objet de valeur.
L'échiquier peut-être au Moyen Age un objet de grand luxe, moins destiné au jeu qu'à de riches collections.
Les manants et les bourgeois se passionnent à leur tour pour les divertissements. Mais si les jeux les plus précieux sont ouvragés en or ... , les vilains doivent se satisfaire de jeux rudimentaires, qu'ils taillent dans le bois. Car un jeu de pièces coûte d'autant plus cher, que les artisans médiévaux ont renoué avec la tradition de figuration. Le roi est représenté siégeant sur son trône, comme la reine. Les Eléphants ont été transformés en Fous, conseillers avisés ... .
Cependant le jeu d'échecs est aussi couplé avec d'autres jeux de table comme la "merelle" ou le "tric-trac". Les pièces d'une grande finesse, sont taillées dans des matières "vivantes" et nobles, comme l'ivoire, la corne, les bois ce cerfs. Elles peuvent être de grande taille et d'un poids conséquent, allant parfois jusqu'à plus d'un kilogramme. Evidemment, ce sont là des pièces d'exceptions et les jeux les plus courants sont généralement de dimensions beaucoup plus modestes et en bois d'essences diverses : Chêne, hêtre, bouleau, ....
Certains jeux sont pourtant de véritables trésors, destinés à être montrés au même titre que des bijoux ou des pièces d'orfèvrerie. En réalité, la puissance symbolique des échecs est telle que posséder un échiquier de valeur revient à affirmer sa suprématie aussi bien matérielle que spirituelle. L'Eglise elle-même ne s'y est pas trompée, qui malgré ses nombreuses revendications possède un nombre considérable de pièces d'échecs.
Evolution des pièces et de l'échiquier à travers le Moyen Age.
Les pièces et les règles des échecs ont beaucoup évolué dès l'apparition du jeu en Europe. Il aurait évidemment été inconcevable que les pièces indiennes et perses ne subissent pas une adaptation aux composantes des armées occidentales. Cette transformation progressive a conduit le jeu à s'affranchir peu à peu de ses origines orientales. Les artistes occidentaux abandonnent rapidement le principe de l'abstraction des figurines inauguré par les musulmans pour respecter la condamnation des images par l'Islam.
C'est donc le grand retour de la figuration, tout au moins pour les pièces les plus riches.
Ainsi l'éléphant, pièce maîtresse du jeu indien ("Chatranj" ou Chaturanga" ancêtre du jeu) qui avait été très fortement stylisée par les Arabes, connaît-il des transformations multiples dictées par son aspect un peu surprenant pour des occidentaux du Xème siècle. Il devient donc "alfinus" , puis " auphinus ", avant de prendre selon les pays l'apparence et les attributs de dauphins, de juges ou d'arbres. Ces évolutions successives de l'éléphant conduisent en définitive à notre fou actuel. Dans les pays anglo-saxons, l'éléphant revêt la forme d'un évêque (bishop), rappelant les responsabilités tant religieuse que militaires de ce prélat au Moyen Age.
Le Vizir, conseiller du shah persan, d'abord conservé en Occident sous sa forme originelle, est bientôt remplacé par un sénéchal appelé fierce avant de devenir au Xème siècle la reine que nous connaissons.
Le char des armées antiques laisse place à la tour assez tardivement, prenant d'abord la forme d'un chameau ou d'une pièce double. On connaît en fait peu de choses des étapes de cette mutation.
Le Shah iranien est rapidement remplacé par le roi, tandis que les chevaux deviennent des cavaliers et que le "baidag" (fantassin) prend le nom de "piéton" avant de devenir notre simple pion.
Les pièces ne sont pas les seules à avoir évolué au cours du Moyen Age.
L'échiquier lui-même n'a été longtemps qu'un simple carroyage monochrome trâcé plus ou moins hâtivement sur des surfaces diverses. Pour des raisons pratiques, les 64 cases sont matérialisées au XI ème siècle par les deux couleurs prépondérantes de l'époque, le blanc et le rouge, qui sont également adoptées pour les pièces des deux camps.
Au cours des siècles suivants, le référentiel de couleurs évolue, faisant du noir et du blanc les deux pôles opposés. De sorte que les pièces noires remplacent progressivement les rouges qui au XIV ème siècle ont pratiquement disparues.
Evolution des règles.
Comme tous les jeux du Moyen Age, les échecs permettent de tromper des heures parfois fort longues, que ce soit dans les châteaux seigneuriaux, dans les demeures bourgeoises ou dans de sombres tavernes. Chacun y joue un peu comme il l'entend, les règles n'étant guère fixées, ce qui donne lieu à de nombreux éclats de voix.
Moultes parties se terminent en véritables rixes, que l'enjeu soit important ou non. Ainsi, dans les "Quatre fils Aymon" "Renaud et Bertolais jouent aux échecs sur le marbre entaillé, et tant ils ont joué qu'ensuite se sont fâchés. Bertolais se courrouce, a Renaud injurié ; une gifle lui donne, le sang en a coulé".
A son arrivée en Occident, le jeu est lourd à mettre en place et assez lent. L'usage du dé, laissant libre cours à trop de duperies, disparaît assez rapidement. Mais le jeu n'a pas encore la vitesse d'exécution que nous lui connaissons aujourd'hui, car trop de pièces ont une faible ampleur de mouvement et une puissance limitée. Nul praticien de renom n'émerge de cet échiquier continental, devenu vulgaire et violent. En outre, sous tous les horizons, une multitude de variantes se développe en marge de la ligne régulière. La raison avec les règles primitives, demeure l'extrême lenteur du jeu. Aussi les Lombards initient le saut du pion de deux cases, et autorisent un coup du roi de deux, trois, voire de quatre pas, lors de son saut initial.
La fierce, ou Vierge, notre reine actuelle, est une des pièces les plus faibles. Elle ne peut se déplacer qu'en diagonale et d'une seule case à la fois.
L'alfin, ou auphin, correspondant à notre fou, a une portée également limitée (deux cases) et avance-lui aussi en diagonale . Par contre, il peut sauter au-dessus des autres pièces.
Le roi, comme aujourd'hui, ne peut bouger que d'une seule case à la fois, mais dans toutes les directions.
Le cavalier est une pièce extrêmement puissante, qui ignore les obstacles. Ses trajets sont les mêmes de nos jours.
La tour (roc) possède déjà ses caractéristiques actuelles, à cette différence près que le roque est possible quelle que soit sa position et celle du roi.
Les pions se meuvent uniquement en avant comme à l'heure actuelle, mais ils ne peuvent avancer de plus d'une case au premier coup. Ils ne peuvent pas non plus prendre en passant. En outre, un roi chrétien ne pouvant décemment avoir plusieurs épouses, ils ne peuvent se transformer en reines à leur arrivée en limite du camp adverse. Ils prennent alors le nom de "dames".
Ces règles de base subissent de nombreuses variations selon les pays ou les joueurs. Les Lombards, par exemple, tentent de re dynamiser le jeu en autorisant le Roi à franchir de deux à quatre cases à son premier coup. En Espagne, des pièces nouvelles apparaissent (licornes, girafes), dotées de pouvoirs étonnants. Mais ces variantes restent le plus souvent locales et limitées dans le temps.
C'est vers la fin du Moyen Age (XV ème siècle) que les règles du jeu se stabilisent enfin, et ce en grande partie sous l'influence de l'oeuvre de Jacques de Cessoles. Le dernier grand bouleversement a lieu vers 1485 : c'est à cette date que la reine acquiert la stature que nous lui connaissons. Les dames prennent le pas sur les lourds cavaliers...
Les règles nouvelles sont instituées vers 1475. Elles semblent sublimer les moeurs héritées du temps des croisades, lorsque les châtelaines, suivant l'avis des princes, des évêques ou des fous, si sages conseillers, géraient les affaires courantes du domaine. Les modifications essentielles concernent l'une, la marche des fous, sans limite en diagonale, l'autre la marche de la reine, sans limite dans toutes les directions. En conséquence, la valeur intrinsèque d'un pion se renforce, puisque celui-ci, après promotion, est communément changé en reine.
Elle paraît loin, désormais, l'époque où les échecs n'étaient qu'un simple champ de bataille...
D'autres études sur le jeu d'échecs paraîtront dans cette rubrique "Historique" notamment sur les premiers écrits, les légendes, les personnages célèbres, la littérature, la peinture, l'ésotérisme autour de l'échiquier ....
Bibliographie :
° Chomarat (Jacques) - Les Jeux à la Renaissance, 1982.
° Cixious (Hélène) - L'Etoffe du Diable, Paris 1991.
° Mehl (Jean-Michel) - Les jeux au Royaume de France du XIII ème au XVI ème siècle, Paris 1990.
° Péchiné (Jean-Michel) - Les Echecs, Découvertes Gallimard, 1997.
° Pastoureau (Michel) - L'Echiquier de Charlemagne, Paris 1990.
° Pastoureau (Michel) - Figures et couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilité médiévale, Paris 1986.
° Histoire Médiéval - n° 5 Janvier/Février 2000.
° Malaplate (J) - Aventuriers du Jeu Royal
° Scheidegger (Claude) - Mille et une anecdotes autour de l'échiquier
________________________
Les parties d'échecs de tous les records
Chaque semaine sur notre site web à la rubrique "nouvelles", nous vous présenterons des parties d'échecs insolites avec des thèmes bien précis : La rubrique "Historique", deviendra ainsi peu à peu le nom qu'elle désigne et la mémoire qu'elle représente. La semaine du dimanche 13 au dimanche 20 juin prochain à consacré quelques exemples sur le thème de la plus longue série d'échecs dans une partie d'échecs : Cela s'est passé en 1986.
*Plus longue série d'échecs : 48 coups consécutifs
Behm - Hitselberger, Racine (Wisconsin) 1986
1.d4 Cf6 2.c4 g6
3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cf3 O-O 6.Fe2 e5 7.d5 Cbd7 8.Fg5 h6 9.Fd2 Cc5 10.Dc2 a5
11.O-O Ce8 12.Dc1 Rh7 13.Ce1 f5 14.exf5 gxf5 15.Cd3 b6 16.Cxc5 bxc5 17.f4 e4
18.Fe3 Cf6 19.Dd1 Fd7 20.h3 De8 21.g4 fxg4 22.hxg4 Cxg4 23.Fxg4 Fxg4 24.Dxg4
Fxc3 25.Rf2 Fxb2 26.Tab1 Fd4 27.Tg1 Df7 28.Th1 Dxf4+ 29.Dxf4 Txf4+ 30.Re2 Fxe3
31.Rxe3 Taf8 32.Tb7 Tf3+ 33.Re2 T8f7 34.Tg1 Ta3

Position après le 38...Tcc3 |
Prochaine partie record : La partie d'échecs ou il y a eut le plus grand nombre d'échecs au roi (aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs) : Aucune idée alors voici un indice : Cela s'est passé en 1991 à Gausdal en Norvège. Réponse dans la rubrique nouvelle (et Historique) avec le diagramme, et la partie pour la semaine prochaine, dimanche 20 juin 2004.
*Plus grande nombre d'échecs au roi dans une partie d'échecs : 141 coups (100 avec les blancs et 41 avec les noirs).
Wegner - Johnsen, Gausdal 1991
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.cxd5
exd5 5.Fg5 Fe7 6.Fxe7 Cxe7 7.dxc5 Cbc6 8.e3 Da5+ 9.Cbd2 Dxc5 10.Cb3 Db6 11.Fe2
Fg4 12.O-O Fxf3 13.Fxf3 O-O 14.Dd2 Tfd8 15.Tfd1 Ce5 16.Cd4 C7c6 17.Fe2 Tac8
18.Cxc6 Txc6 19.Tac1 Txc1 20.Dxc1 h6 21.Dd2 Dg6 22.Dc3 Dd6 23.h3 a6 24.Td2 Rh7
25.Dc2+ g6 26.Dd1 Dc5 27.Ff1 Rg7 28.b3 Rh7 29.g3 d4 30.exd4 Txd4 31.Txd4 Dxd4
32.Dxd4 Cf3+ 33.Rg2 Cxd4 34.f4 Rg7 35.Rf2 Rf6 36.Fd3 h5 37.Re3 Cf5+ 38.Rf3 Cd6
39.b4 Re6 40.g4 hxg4+ 41.hxg4 Rd5 42.Re3 Cc4+ 43.Fxc4+ Rxc4 44.Re4 Rxb4 45.Re5
Ra3 46.Rf6 b5 47.f5 gxf5 48.gxf5 b4 49.Rxf7 Rxa2 50.f6 b3 51.Rg7 b2 52.f7 Db1
53.Df8 Dg1+ 54.Rh6 De3+ 55.Rh5 De5+ 56.Rh6 De6+ 57.Rh5 Dd5+ 58.Rh6 a5 59.Df2+
Rb3 60.Dg3+ Rb4 61.Db8+ Rc5 62.Da7+ Rb5 63.Db8+ Ra6 64.Dc8+ Rb6 65.Db8+ Db7
66.Dd8+ Dc7 67.Dd3 Df4+ 68.Rh7 Dh4+ 69.Rg6 Dg4+ 70.Rh6 Df4+ 71.Rh7 a4 72.Db1+
Rc5 73.Dc2+ Dc4 74.Df2+ Dd4 75.Dc2+ Rb4 76.Db1+ Ra3 77.Dc1+ Db2 78.Dc5+ Ra2
79.Dc4+ Db3 80.De2+ Ra1 81.Rh6 Db6+ 82.Rh5 Dc5+ 83.Rh6 a3 84.Dd1+ Rb2 85.Dd2+
Rb3 86.Dd3+ Rb4 87.Dd2+ Rb5 88.Dd3+ Rb6 89.Dd8+ Rc6 90.De8+ Rc7 91.Df7+ Rb6
92.Db3+ Ra5 93.Da2 Ra4 94.Rh7 Dh5+ 95.Rg7 Dg5+ 96.Rh7 Df5+ 97.Rg7 Dd3 98.Rh6 Rb4
99.Rh5 Dc4 100.Dd2+ Rb5 101.Dd7+ Ra5 102.Dd2+ Db4 103.Dd8+ Db6 104.Da8+ Rb4
105.De4+ Rc3 106.De1+ Rb2 107.Dd2+ Ra1 108.Dd1+ Ra2 109.Dc2+ Db2 110.Dc4+ Db3
111.De2+ Rb1 112.De1+ Rb2 113.De2+ Dc2 114.De5+ Rb1 115.De1+ Ra2 116.Re6+ Db3
117.De2+ Rb1 118.De1+ Rb2 119.Df2+ Dc2 120.Df6+ Dc3 121.Df2+ Rb3 122.Db6+ Ra4
123.Db1 Dh3+ 124.Rg5 Dg2+ 125.Rh5 Dd5+ 126.Rh6 a2 127.Dc2+ Rb5 128.Db2+ Rc6
129.Dc3+ Rd7 130.Dg7+ Rd8 131.Da1 Dd2+ 132.Rh5 Rc7 133.De5+ Rc6 134.De8+ Rc5
135.Dc8+ Rb4 136.Db7+ Ra4 137.Dc6+ Rb3 138.Db5+ Db4 139.Dd3+ Ra4 140.Dd1+ Db3
141.Dd4+ Rb5 142.Dd7+ Ra6 143.Dc8+ Ra5 144.Dd8+ Rb4 145.Dd6+ Rc4 146.De6+ Rc3
147.De5+ Rc2 148.De4+ Dd3 149.Da4+ Rb1 150.Db4+ Rc1 151.Dc5+ Rd1 152.Dg1+ Rd2
153.Dg5+ Re1 154.Dh4+ Rd1 155.Da4+ Rc2 156.Dd4+ Re2

Position après le 200.Db2+ |
Prochaine partie record : La partie d'échecs ou il y a eut la plus longue serie d'échecs mutuels (aussi bien avec les blancs qu'avec les noirs) : Aucune idée alors voici un indice : Deux parties existes. Cela s'est passé en 1985 pour les deux parties (Budapest et Copenhague). Réponse dans la rubrique nouvelle (et Historique) avec le diagramme, et la partie pour la semaine prochaine, dimanche 27 juin 2004.
*La plus longue serie d'échecs mutuels : 5 coups
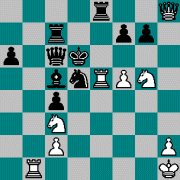 Van Mil - Kas Budapest 1985 1.Txd5+ Dxd5+ 2.Cge4+ Dxe4+ 3.Cxe4+ et les Blancs gagnent |
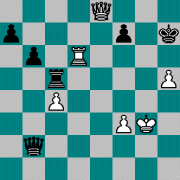 Blees - Plachetka Copenhagen 1985 48.Dxf7+ Dg7+ 49.Dg6+ Dxg6+ 50.hxg6+ et les Blancs gagnent. |
Dans un problème, une serie de 37 coups consécutifs et mutuels à été recensé et archivé. A voir l'histoire de ce problème ici : http://www.xs4all.nl/~timkr/chess/check.html
Prochaine partie record : La partie d'échecs ou il y a eut la plus longue serie de prises consécutives : Aucune idée alors voici un indice : Cela s'est passé en 1988 en Allemagne entre Blodig - Winner. Réponse dans la rubrique nouvelle (et Historique) avec le diagramme, et la partie pour la semaine prochaine, dimanche 04 juillet 2004.
*La plus longue serie de prises consécutives : 17 coups
Blodig - Wimmer, Germany 1988

Avant |
1.g3 e5 2.Fg2 d5 3.d3 Cf6 4.Cf3 Cc6 5.O-O h6 6.c3 Fe6 7.Cbd2 Dd7 8.b4 a6 9.a4 Fd6 10.Fb2 O-O 11.b5 Ca5 12.c4 dxc4 13.dxc4 Cxc4 14.Cxc4 Fxc4 15.Cxe5 Fxe5 16.Fxe5 Dxd1 17.Tfxd1 axb5 18.Fxb7 Txa4 19.Txa4 bxa4 20.Fxc7 Fxe2 21.Td4 Te8 22.Fd6 Td8 23.Te5 Txd4 24.Fxd4 a3 25.f3 a2 26.Rf2 Fc4 27.Fc6 Ch7 28.h4 Cf8 29.Fa4 Ce6 30.Fa1 Cc5 31.Fc2 Fb3 32.Ff5 g6 33.Fh3 Fe6 34.Fxe6 fxe6 35.Re3 Cb3 0-1 |  Après
Après |
Et
un "sous record' : 10 coups consécutifs
avec prises.
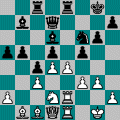 Position après 27.e4 Position après 27.e4 |
Merci de votre attention et à bientôt ...